| Année : | 2010 |
| Réalisé par : | Dyana Gaye |
| Durée : | 48 minutes |
| A partir de : | 8 ans |
À la gare routière de Dakar, un taxi s’apprête à partir pour Saint Louis. À bord, Souki, Malick, Madame Barry, Joséphine et Binette. Il manque un passager, Antoine, un Français étudiant la musicologie qui les a ratés de peu. Parti à leur poursuite, ce dernier rencontre la nièce de Madame Barry, Dorine, jeune apprentie coiffeuse en quête de liberté qui, elle aussi, part pour Saint Louis. La route est longue, la chaleur intense et les routes surchargées. Le français se mêle délicieusement au wolof, les chansons aux dialogues. Le temps du voyage va permettre à ces personnages, que rien ne lie a priori, d’unir leur destin.

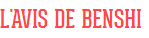
Moyen métrage de 48 minutes et comédie musicale qui se frotte à la réalité de la société sénégalaise, Un transport en commun est un film atypique, petit ovni du cinéma français, dans lequel la réalisatrice Dyana Gaye explore sa double appartenance culturelle (franco-sénégalaise) de manière fine et singulière, à la recherche des fragilités qui font le sel de la vie plutôt que de la perfection du grand cinéma de genre.
L’histoire commence dans le brouhaha de la gare routière de Dakar, au cœur de la société sénégalaise bouillonnante. Médoune Sall, le vieux chauffeur de taxi cherche à remplir sa voiture pour faire le trajet vers Saint Louis. Quand tout à coup les passagers s’insurgent « Mais où est passé le septième passager ? » qui les retarde tous. Les comédiens se mettent à chanter et danser, et le spectateur en reste bouche bée. Passant d’un registre quasi documentaire à celui de la pure comédie musicale à la Jacques Demy, le pacte cinématographique est scellé et le spectateur n’a plus qu’à se laisser porter par la fantaisie.
Le projet de Dyana Gaye était avant tout de réaliser un film choral. Un film où de multiples personnages se croisent, se rencontrent sans que l’un prenne le pas sur l’autre. Des personnages qui n’ont rien à voir les uns avec les autres et qui ne se connaissent pas se retrouvent enfermés dans un taxi le temps d’un trajet Dakar-Saint Louis. Il y a les deux françaises en vacances « au pays », envoyées chez le grand-père à Saint Louis après avoir trop fait la fête à Dakar : Binette et Joséphine ; la femme d’affaire tenue par les contradictions de la société sénégalaise et aux prises avec les distorsions entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle faite d’ambition, de réussite et d’émancipation : Madame Barry ; le jeune homme qui désire voyager en Italie pour découvrir le monde (et non forcément émigrer comme l’est très souvent représentée la jeunesse africaine au cinéma) : Malick ; la jeune femme, Souki, qui se fait le devoir d’honorer la mémoire de son père avant de vivre sa vie à elle ; ou Dorine qui rêve d’amour romantique et d’émancipation ; le toubab français débarqué dans une réalité africaine dans laquelle il semble complètement décalé : Antoine. Enfin le vieux sage, l’ancien, l’homme d’expérience et porteur de mémoire dont peut-être une partie acquise par un bout de vie vécue en France, celui qui littéralement conduit la troupe : Médoune Sall, le chauffeur de taxi. Il est celui qui interpelle la jeune génération pour la mettre en garde contre l’aliénation culturelle et économique qu’elle subit et accepte trop facilement ; celui qui se révolte contre la fatalité et le néo-colonialisme ; celui qui réaffirme son appartenance face aux jeunes qui sont aimantés par l’occident. Médoune Sall répond directement au discours de Dakar du président Sarkozy : « j’ai mal d’entendre que la France est l’amie de l’Afrique » dans une chanson-tract imaginée par la réalisatrice comme un slam (Mbokk Mbakh - Compagnon de case).
La comédie musicale est ce qui permet, en plus de l’enchantement du genre, de donner de l’épaisseur aux personnages, de les faire exister au delà des archétypes. Les moments chantés expriment l’intériorité de chaque personnage et les chansons (tant dans leurs paroles que dans leur style musical) ont été précisément écrites pour donner une « couleur » à chacun d’entre eux. Mme Barry ne pouvait exprimer sa souffrance qu’à travers un blues. Malick et son fantasme d’Italie s’exprime dans un twist teinté de mandoline. Souki, qui quitte l’enfance pour entrer dans sa vie de femme après le deuil de son père, débute sa chanson par une comptine et la poursuit sur un air doux et mélancolique, elle chante dans sa langue. La chanson-tract de Médoune Sall devait forcément être chantée en wolof et les percussions lui donnent son appartenance à la culture africaine, dont il revendique la richesse. Enfin la chanson d’amour entre Dorine et Antoine est une reprise assumée de la poursuite amoureuse entre Delphine et Maxence dans Les demoiselles de Rochefort.
Classiquement, la comédie musicale, genre très codé du cinéma, est un genre de studio, répété, millimétré, interprété par des danseurs professionnels de haut niveau, qui exécutent des numéros spectaculaires. On se situe dans l’ordre de l’enchantement, du spectaculaire et de la perfection. Ce qui intéresse ici Dyana Gaye est la rencontre de ces codes esthétiques venus de l’occident avec une réalité sénégalaise qu’elle traite sur un mode documentaire. La confrontation, le frottement, d’un dispositif fictionnel très écrit avec le désir de retranscrire la réalité d’une société rarement montrée au cinéma.
Mais dans cette économie du moyen métrage, qui est un choix artistique délibéré, il ne s’agit pas de travailler la perfection mais bien au contraire la fragilité : fragilité des corps et des voix d’acteurs essentiellement non professionnels. C’est ce qui intéresse la réalisatrice : la fragilité des voix, l’imperfection des gestes qui nous rapprochent de la vie et nous éloigne d’une image lissée de studio appartenant au genre. De cette manière, elle touche juste. Nous ne sommes pas à Hollywood mais bien à Dakar, dans une comédie musicale tournée en extérieur au milieu de la foule sénégalaise, autant spectatrice qu’actrice du film en train de se fabriquer sous ses yeux. Car comme dans tout film, même documentaire, le réel est mis en scène, ou au moins travaillé. Installer une grue au milieu de la gare routière de Dakar ne peut pas passer inaperçu, transformant le lieu de la vraie vie en théâtre pour les usagers et habitants du lieu. Ils sont là, dans le film. On les voit dans le cadre continuer leur vie alors que les acteurs entament leurs mouvements de danse et leurs chansons, faisant basculer le spectateur du registre du réalisme à celui du fantastique et de l’enchantement.
Cette rencontre entre des codes esthétiques occidentaux et la réalité sénégalaise, c’est comme le dirait Dyana Gaye : « la rencontre de (ses) deux moi ». Son cinéma est simplement du cinéma, c’est à dire une expression artistique : il n’est ni identitaire, ni communautaire, elle vit sa double appartenance culturelle simplement comme une richesse. N’ayant pas vécu au Sénégal, c’est cette part d’elle même qu’elle interroge dans ses films. Aujourd’hui son imaginaire travaille au Sénégal mais l’appartenance culturelle n’est pas pour elle un moteur de l’écriture cinématographique.
Un transport en commun est un film particulièrement original et intéressant à faire découvrir à des enfants qui seront forcément emportés par la jubilation de la comédie musicale.
Cinéma jeune public et ciné-club. Films de qualité depuis 1926.